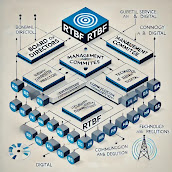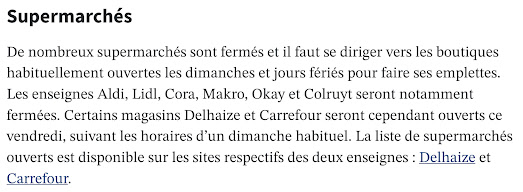Dans leur couverture de la campagne présidentielle américaine, les médias nous ont eus. Jouant une nouvelle fois "le mauvais" versus "la bonne", ils nous ont donné ce que nous voulions entendre : la possible victoire du bien contre le mal. Alors que, objectivement, "le Diable" avait tout pour réussir face à la "Bonne Dieue"."L'une des élections présidentielles les plus serrées de l'histoire américaine", voire, pour certains médias, "la plus serrée". En tout cas, celle qui aura connu "les sondages les plus serrés". D'autres, un peu plus prudents, parlaient bien du "scrutin le plus incertain." Mais, la veille du vote, nombre des médias se demandaient encore : "Que se passera-t-il en cas d'égalité entre les deux candidats ?", expliquant à longueur de textes qu'au pays de l'oncle Sam, "le futur président pourrait être élu malgré un vote populaire défavorable".
Résultat des courses : à ce jour (07/11), Trump compte 295 grands électeurs et Harris 226, le candidat républicain recueillant près de 51% des suffrages, contre 47,6% pour sa challenger. Les médias n'avaient-ils pas eu raison ? Quelle course serrée, les amis ! Quelle bataille dont le résultat était incertain jusqu'au dernier vote !
TROP BEAU SCÉNARIO
Rarement sans doute on aura connu un aussi grand gap entre le scénario que les médias ont voulu nous faire croire et la réalité des urnes. Et ils y ont cru, les lecteurs, les téléspectateurs, les internautes. Pendant des semaines, ils se sont dit que non seulement tout n'était pas foutu, mais que Harris avait, en définitive, toutes les chances de l'emporter face à un grand méchant loup si horrible, dont la victoire ne pouvait pas seulement être impensable. Elle l'était. Tout simplement.
Les médias nous ont raconté une belle histoire, à coup de reportages et de documentaires élogieux sur la belle candidate démocrate, défenseuse de la veuve et de l'orphelin, sur ses électeurs issus des bas-fonds des minorités, et sur ses propagandistes si courageux. Et, à l'opposé, à coup d'autant de reportages et de documentaires catastrophistes sur l'horrible candidat républicain, à propos duquel il n'est pas utile de répéter ici tous les qualificatifs négatifs dont il a été affublé. Ni énumérer la liste des sujets de JT où les médias ont dézingué ses électeurs, dont on se demandait à chaque fois s'il pouvait réellement exister aux USA des gens aussi bêtes, imbéciles, sinon timbrés.
Depuis l'été, on en a été servis, en reportages recueillis aux quatre coins de cet immense pays. Et plus on en voyait ou on en lisait, plus le pronostic devenait indiscutable : dans cette bataille de l'ange contre le démon, Kamala ne pouvait que l'emporter. Les sondages, d'ailleurs, ne disaient pas autre chose. Il y avait bien cette foutue question de la marge d'erreur, qui faisait qu'en finale ces sondages ne pouvaient rien prédire, mais on s'en foutait. Considérer quelque chose qu'on redoute comme impossible est d'un rassurant incontestable.
UNE HISTOIRE SI BELLE. ET POURTANT…
Nos médias n'ont pas joué le suspense, comme ils le font parfois, posant dans la balance le pour et le contre et se gardant bien de dire vers qui allait leur cœur. Cette fois, ils y ont été franc-jeu. Leur public voulait la victoire du bien contre le mal ? Ils ont bâti leurs récits dans ce but. Pour aller dans le sens de leurs audiences, certainement. Mais aussi, plus prosaïquement, parce que les médias eux-mêmes rêvaient de la même chose. Emportés par leurs propres narrations, journalistes, présentateurs, documentaristes ont tous choisi de magnifier la geste de Kamala et de présenter avec noirceur l'impitoyable univers de son adversaire. L'histoire était trop belle pour ne pas être celle qui devait survenir.
Et pourtant… N'est-ce pas oublier un peu vite que, jusqu'à cet été, tout le monde ou presque était persuadé que l'élection américaine était pliée d'avance. Que, face à un vieillard qui s'accrochait à son perchoir mais désespérait chaque jour davantage ses supporters, Trump avait déjà gagné. Malgré ses outrances, ses procès, ses condamnations et ses incroyables électeurs. Jusqu'au 21 juillet dernier, il n'y avait pas d'espoir. Biden avait beau présenter un bilan économique positif, cet homme en fin de course faisait simplement pitié.
Tout s'est renversé le jour où le vieux président a annoncé son retrait de la course. Comme s'il craquait alors une allumette dans une pièce plongée dans le noir, la petite lueur d'un autre chose est apparue. Cela changeait tout. À la nuit succédait la lumière du jour, qui plus est incarnée s'il vous plaît par une femme plus jeune, plutôt avenante, toujours bien habillée, avec un beau collier de perle, "libérée, délivrée", à l'histoire incertaine certes, mais emblématique de ce que doit être "le rêve américain". Que du bonheur. Et tout le monde y a cru.
LA FIN DU SORTILÈGE
Il est incroyable qu'il ait fallu que la reine des Neiges s'écrase face à l'horrible Hans pour que le sortilège s'arrête et que, tout à coup, les commentateurs politiques retrouvent un peu de distance face aux événements.
C'est vrai, finalement, que le programme de Kamala Harris, on n'en a jamais rien su. Alors que Trump, préparé au combat pendant quatre ans, avait clairement défini les quelques axes sur lesquels il allait faire campagne à grand renfort de slogans simples et compréhensibles. Petit indice significatif : dans les bandes-annonces des radios et des télévisions à propos de ces élections, illustrer les dires de Trump par quelques mots ne posait aucun problème, à commencer par le célèbre "Kamala you're fired" (dont plus personne n'a relevé que Trump l'avait utilisé parce que c'était sa phrase favorite quand il jouait dans la télé-réalité The Apprentice). Pour Kamala, impossible par contre de trouver une phrase clé. Alors, on choisissait les seuls propos qui semblaient la représenter : "Thank you, thank you"…
Devant cette carence de programme clair, rares ont aussi été les commentateurs à relever avant le krach du 5 novembre que, pendant la campagne, Harris et tout le camp démocrate avaient passé la majeure partie de leur temps à réagir aux outrances et aux déclarations de Trump, et non à lancer des messages sur leur propre projet. Dans ce match, Kamala a rarement gardé la balle très longtemps. C'était Donald qui était à l'attaque. En réagissant à ses dires, les démocrates faisaient plus grandir leur adversaire que marquer des points…
C'est après le désastre qu'on s'est aussi souvenu que la candidate démocrate n'avait eu que trois mois pour faire campagne, sans incarner autre chose que le rôle d'une remplaçante de dernière minute, dont on se demande toujours pourquoi Biden l'avait si mal mise dans la lumière tout au long de son mandat. Qui se rappelle que, lorsqu'il avait été élu, on avait dit que Biden, reconnaissant son âge, s'était engagé à démissionner à mi-mandat en faveur de sa vice-présidente ? L'expérience Kamala sur le terrain l'avait-elle dissuadé de mettre cet engagement à exécution ? Ou, grisé par le pouvoir, avait-il préféré oublier Kamala, jusqu'à se déclarer prêt à briguer lui-même un second mandat ? Le président sortant, en tout cas, n'a rien fait pour aider sa vice-présidente à lui succéder. Quand les correspondants de presse aux USA se sont contentés de dire que "si on ne connaît pas Kamala, c'est que le rôle d'un vice-président est juste de s'apprêter à remplacer le président", c'était aller un peu vite en besogne. Un vice-président ne se trouve pas pendant quatre ans dans un placard en attendant de sortir du trou en cas d'urgence…
TABASCO KAMALA
Qui a osé dire que l'ancien procureur de Californie était peut-être en fait un second couteau, loin de cocher toutes les cases pour être le meilleur candidat contre Trump ? Le conte de fées bâti à son propos ne l'aurait pas supporté.
C'est aussi au lendemain de la catastrophe qu'on s'est remis à parler du "plafond de verre" que les femmes politiques rencontrent aux USA. Comme si on avait imaginé pendant la campagne qu'il n'existait plus, à défaut de n'avoir jamais existé.
Qui avait eu le courage de reconnaître que, moins que Hillary Clinton mais quand même, Kamala Harris appartenait à cette intelligentsia de gens très éduqués qui constitue l'essentiel des hautes sphères du parti démocrate, et que le fossé entre ces élites et l'électorat traditionnel de ce parti ne cessait de s'agrandir ?
À l'époque où les films de Noël commencent déjà à revenir sur les écrans des télés, l'histoire de Kamala était trop belle. Elle ravivait d'une belle dose de Tabasco le Bloody Mary aqueux et sans goût que devait être l'élection 2024. Il faut dire que, de ce point de vue en tout cas, la recette a plus que réussi. D'un duel perdu d'avance, les médias ont réussi (ou presque) à faire The Biggest Story Ever Told. Et tout le monde est rentré dans le jeu.
Mais lorsqu'on joue ce petit jeu plus dure est la chute, et plus pénibles sont
les réveils. Alors que si, au lieu de se laisser bercer par cette féérie, on avait gardé les yeux grand ouverts en permanence, on n'aurait pas eu besoin de se pincer bien fort le 6 novembre au matin et de se dire : "Trump président ? Mais je rêve !". Non, vous ne rêviez pas…
Frédéric ANTOINE.
PS: Ceci est une réflexion médiatique générale, pas l'analyse scientifique d'un corpus précis. Que les médias qui ne se reconnaitraient pas dans les commentaires apportés ici ne se sentent pas visés par les appréciations contenues dans ce texte.